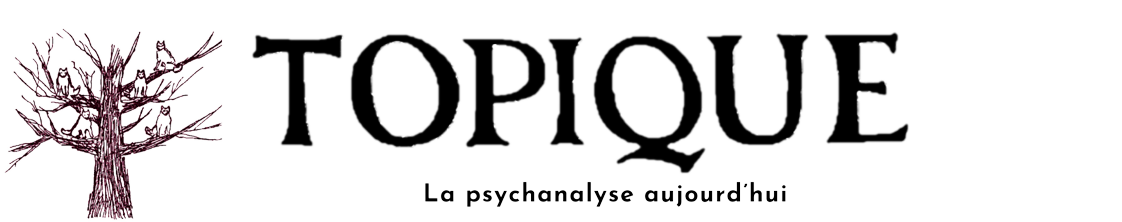Pulsion du normatif
Les sociétés modernes, individualistes, ne sont pas moins normées que les sociétés anciennes, holistes, mais leur nouveauté tient à ce que ces normes sont au service du travail de construction de soi de chaque individu. Soutenu par le caractère immanentiste de la société libérale, le travail de la politique et du droit consiste à assurer le « devenir-sujet » de chaque individu hors de toute contrainte issue des traditions morales et religieuses. Aucune borne n’est plus imposée au travail de la liberté individuelle jusqu’à atteindre le donné le plus objectif de la condition humaine : les coordonnées de la sexualité. C’est cette illimitation de la liberté de construction des identités sexuelles qui a été critiquée par une certaine psychanalyse lors des débats qui ont accompagné les derniers changements législatifs ouvrant le mariage aux couples homosexuels. La pensée analytique, en particulier lacanienne, a été sollicitée et instrumentalisée pour rappeler à l’ordre ceux qui défendaient une conception relativiste et constructiviste des identités sexuelles. Le sexuel a été rabattu sur l’anatomie, à partir d’un rehaussement de la Nature niant tout ce que fut l’histoire de l’humanité : celle d’un arrachement long et continu, par le langage et la symbolisation, aux lois données pour intangibles de la condition humaine. C’est ce retour d’une normativité intransigeante, assise sur une inflexion naturaliste et traditionaliste de la pensée analytique, que l’on voudrait examiner pour en saisir les ressorts ainsi que les implications anthropologiques et politiques.
- modernité
- nature
- anatomie
- normes sexuelles
- construction identitaire
- différences de genre